Ce jeudi 5 juillet, aux alentours de 19 heures, je recevais ce courriel de la part de Lysiane Rolland, écrivaine mais aussi , et depuis si longtemps, fidèle collaboratrice dans les Cahiers de l’Entre-deux-Mers, ces petits cahiers qui furent également à l’origine de sa rencontre avec l’écrivain Michel Suffran…
 « Bien plus qu’un ami, il était mon frère d’âme et mon modèle en écriture, dans ce monde sans pitié de l’écriture, il était celui qui me donna confiance et force d’en être ! Il était l’érudit humble qui parfois me demandait mon avis sur un sujet métaphysique et écoutait ma réponse balbutiante qui faisait ce qu’elle pouvait face à cet écrivain archi reconnu ! Je lui disais Michel, ne me comparez pas à vous ! Savez-vous qui vous êtes ? Il y a peu nous étions passé au tutoiement, j’ai mis presque 20 ans pour oser lui dire « tu », cela l’amusait ! Il aimait notre jardin, me disait vous habitez un Eden ! J’étais si honorée qu’il s’y plaise avec Colette (son épouse) devenue mon amie et complice dans l’amour des chiens, chats, oiseaux…Chez lui je retrouvais nos points communs, le goût des jouets anciens, des boites en fer que nous collectionnions tous les deux !…Avec lui j’entrais au pays des merveilles lorsqu’il parlait de Mauriac ou de Colette (l’écrivain !) qu’il avait rencontrés ! Il y a peu il m’a offert une préface pour mon prochain livre alors que la maladie lui déclarait sa dernière bataille ! Michel Suffran s’est envolé ce matin ! Ma peine est immense ! » Lysiane Rolland. (crédit photo Alain Rolland).
« Bien plus qu’un ami, il était mon frère d’âme et mon modèle en écriture, dans ce monde sans pitié de l’écriture, il était celui qui me donna confiance et force d’en être ! Il était l’érudit humble qui parfois me demandait mon avis sur un sujet métaphysique et écoutait ma réponse balbutiante qui faisait ce qu’elle pouvait face à cet écrivain archi reconnu ! Je lui disais Michel, ne me comparez pas à vous ! Savez-vous qui vous êtes ? Il y a peu nous étions passé au tutoiement, j’ai mis presque 20 ans pour oser lui dire « tu », cela l’amusait ! Il aimait notre jardin, me disait vous habitez un Eden ! J’étais si honorée qu’il s’y plaise avec Colette (son épouse) devenue mon amie et complice dans l’amour des chiens, chats, oiseaux…Chez lui je retrouvais nos points communs, le goût des jouets anciens, des boites en fer que nous collectionnions tous les deux !…Avec lui j’entrais au pays des merveilles lorsqu’il parlait de Mauriac ou de Colette (l’écrivain !) qu’il avait rencontrés ! Il y a peu il m’a offert une préface pour mon prochain livre alors que la maladie lui déclarait sa dernière bataille ! Michel Suffran s’est envolé ce matin ! Ma peine est immense ! » Lysiane Rolland. (crédit photo Alain Rolland).
Ainsi Michel Suffran s’en est allé laissant un ultime cadeau à Lysiane, une dernière préface pour son prochain livre qui doit paraître incessamment…
Leur amitié si improbable et profonde avait commencé grâce à un numéro des Cahiers de l’Entre-deux-Mers, (n°47,1994) où dans la rubrique bibliographique, il était fait mention du premier livre de Lysiane intitulé « Signes et Demeures » (édition du Greffier) à la suite de quoi, Michel Suffran, fidèle lecteur, avait contacté l’auteure. Cette rencontre, la naissance de l’histoire de leur amitié, Michel la racontera dans la préface qu’il consacrera par la suite au recueil de nouvelles ayant pour sujets ces vieilles maisons, ces « Demeures » avec lesquelles Lysiane entretient une relation toute particulière. Cette préface de Michel Suffran en dit long aussi sur ce qu’il était en tant qu’écrivain non seulement érudit, profondément attaché à sa région, sa ville Bordeaux, mais aussi en tant qu’homme sensible, à l’écoute, toujours bienveillant et si proche de ceux qu’il côtoyait. Cette préface la voici :
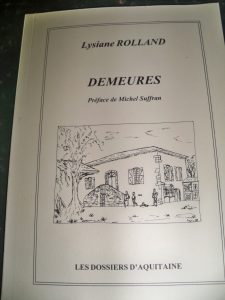 De quelques « Domaines hantés ».
De quelques « Domaines hantés ».
Je me souviens de l’émotion qui fut la mienne, voici trois ans déjà, en découvrant dans « Les Cahiers de l’Entre-deux-Mers », le « portrait de maison », qui clôt, à présent , ce recueil. L’auteur, Lysiane Rolland, m’était inconnue et pourtant, en la lisant, j’ai eu l’immédiate certitude de recevoir le message d’une amie de longue date, d’une sorte de cœur selon l’esprit.je dis cela sans nulle exagération, comme je l’ai ressenti. Et la meilleure preuve en est que –chose qui m’arrive très rarement- j’ai éprouvé aussitôt le désir d’écrire à son auteur, je devais dire plutôt, de « lui répondre » comme on se doit de répondre à une lettre qui touche une part secrète et profonde de soi même.
*Ce fut le début d’une correspondance et, aussi, je puis le dire d’une amitié. Au cours des mois qui suivirent, il m’a été donné de lire d’autres textes de Lysiane Rolland, tous marqués de cette empreinte indéfinissable, à égale distance du poème, du récit, du souvenir, participant d’un étroit amalgame, dont elle détient le secret miraculeux, entre ces trois éléments, si difficilement conciliables. Mon, admiration pour l’écrivain très rare révélé en cette jeune femme s’en est encore accrue et, aussi le sentiment de me retrouver en « « pays de connaissance ».
Je voudrais m’expliquer sur ce dernier point : mon enfance –qui fut en partie rurale- s’est déroulée en des paysages et des maisons différents, sans nul doute, de ceux si subtilement dépeints ici. Et pourtant (est-ce la magie de l’écriture ou bien, le réseau de connivences, le tissu d’instants et d’émotions dans la trame duquel leur évocation s’inscrit en filigrane ?) j’ai ressenti, à chaque instant, l’impression, la certitude d’un merveilleux rapatriement.
Voilà ce qui vient raviver aujourd’hui la lecture de ce recueil. Et, déjà, son titre : « Demeures ». Pareil mot m’a toujours troublé, car, à la notion de lieu enclos, de murs dressés, de « maisons fugitives » (pour reprendre Mauriac, citant lui-même Proust) il associe une dimension intemporelle, faite à la fois de mémoire et de ferveur, et que symbolise à merveille l’essence même de l’acte d’écrire, c’est-à-dire la tentative de sauver de l’oubli, de l’abandon, peut être de la ruine, un espace familier où nous avons aimé, espéré, rêvé parfois aussi souffert.
Écrire, c’est tenter de réparer une perte – toujours enfouie, toujours douloureuse : même si par bonheur, nous continuons à habiter les places fortes de notre enfance, quelque chose d’elles, s’en est allé, fatalement subtilement, au fil du temps, des présences effacées, des saisons mortes, des soleils éteints. La quintessence, pourtant, en est toujours là, non certes figé dans un décor immuable, mais en suspension parmi les jeux subtils de l’ombre et de la lumière, cloîtrée au plus profond des pièces calfeutrées. Et aussi dans les innombrables appels de ce réseau sonore, à peine, perceptible que nous baptisons un peu vite le « silence ». Et enfin dans les odeurs, les arômes, les effluves- tout ce qui crée le corps astral de ces êtres de pierre, de bois et d’argile que sont les « maisons d’haleine » chères à William Goyen. Or, cela, nul ne pourra nous l’arracher, tant le préservent son essence immatérielle, son caractère intemporel, donc indestructible. Une Demeure, ce qui demeure – ce minuscule fragment de réalité où nous avons vécu et qui nous hantera, à tout jamais ! […]
Le livre de Lysiane Rolland suscite, en notre repli de terre girondine, une atmosphère aussi troublante. C’est un truisme un, peu trop conventionnement « poétique » que d’affirmer combien « les maisons ont une âme ». Mais c’est tout autre chose, et qui n’appartient en propre qu’au véritable écrivain, que de rendre cette âme palpable, respirable, presque visible, et sans, pour autant, lui ôter la moindre parcelle de son mystère. L’auteur évoque, dès son premier récit, la « communion solitaire de la pierre et de l’eau », l’emprise qu’exerce une part immergée d’elle-même « cette maison sacrifiée à la rivière » ainsi que « son irrépressible envie d’être là-bas ».(Et, je me rappelle, ici, une brève nouvelle d’André Maurois intitulée La Maison, où une jeune femme rêve avec tant de force et de constance à une demeure à l’abandon qu’elle en devient, sans même sans douter, le fantôme familier).
La communion de Lysiane Rolland avec les lieux qu’elle « hante », afin de la mieux ranimer par la puissance vive du souvenir, se révèle, tout à la fois, spirituelle et charnelle. Nous voici proches, bien sûr de la thématique bachelardienne, mais l’on s’en voudrait de surcharger par trop de références philosophiques ou littéraires un mouvement spontané, un élan instinctif jailli de la profondeur de l’être.
En effet, au long de ces pages, tout filtre par l’alchimie d’une sensorialité constamment en éveil. C’est là, me semble-t-il, un privilège à peu près d’absolu propre à la féminité : le troublant pouvoir d’instaurer avec les choses, les plantes, les éléments, les pierres, les instants, une relation, de conscience à conscience, une connivence de personne à personne. Lorsque la narratrice parle de « la terre odorante , amollie et lascive », de son désir révélé « sous le vieux noyer, avec les odeurs du jardin, de « caresser de l’esprit son bonheur de femme, de mère, comme on flatte un chat alangui », nous sentons bien, nous, en cette plénitude heureuse, percer la promesse d’un Éden à la fois tentateur et innocent, l’imminence d’un monde désormais mystérieux mais qui fut, il y a bien longtemps, notre royaume originel.
Et quand ; un peu plus loin, la même jeune femme effleure du bout des doigts « les murs où demeure prisonnier le temps, les pierres chaudes, douces et vivantes », nous franchissons un pas de plus, à sa suite, vers la vision franciscaine d’un univers réconcilié.
Le cœur de la maison, la couleur aussi de sa propre réalité, l’héroïne de la nouvelle finit par le découvrir lorsque derrière la porte condamnée, au fond du grenier interdit, son regard se mêle à celui d’un oiseau nocturne, véritable génie du lieu. Alors, dans un éclair, elle en reçoit « le message intraduisible, inexplicable ». Elle sait qu’elle se trouve, à présent « au cœur d’elle-même ». Pareille au petit être indistinct qu’elle porte en son ventre, elle se love au sein de ce refuge et, pacifiée, s’endort, persuadée qu’elle enfantera « une fille, très douce, ayant une mystérieuse connaissance des choses invisibles ».
Là, peut-être, au terme du voyage initiatique au centre de soi-même, dont la maison est le symbole en pleine lumière, réside le secret d’un art fait de sensualité généreuse et d’innocence préservée. Lysiane Rolland n’est pas de la race de ceux qui « perdent leur enfance comme une poignée de sable » Ainsi que le semis caillouteux du Petit Poucet, son long fil d’or lui permet d’affronter, au prix d’une quête ardente mais non sans péril, de sombres entrelacs de souterrains, d’eaux mortes, de chambres condamnées, de portes dérobées. Car, aux étapes de ses chemins labyrinthiques, toutes les Demeures de rencontre ne sont pas, il s’en faut, habitées de présence tutélaires : certaines dissimulent derrière un masque pétrifié des semences de mort, de désolation,, de folie. Pourtant aucune d’entre elles ne saurait être rejetée comme hostile ou étrangère. La plus rébarbative mérite au moins, une tentative d’apprivoisement. Chacune, à sa façon, nous est familière ou –qui sait ?- complice de secrets assoupis, de désirs en attente, pareils à d’anciennes cicatrices cachées dans les replis de notre esprit et de notre corps. Peut-être, après tout, est-ce la mauvaise conscience des hommes qui, seule, a fini par pénétrer et miner leur hospitalité première. Pourtant ces puits de tous les vertiges, tout autant que les lieux d’asile et de paix, nous attirent, car leur enténèbrement reflète des parcelles humiliées, jamais reniées, de notre oublieuse mémoire…
Toutefois le dernier mot se doit de rester « aux promesses de l’aube ». Aussi le voyage finissant, nous entraine-t-il vers les plus ténus, les plus vulnérables et, cependant, les plus obsédants de nos refuges : « les maisons de feuilles » de l’enfance, cabanes de ramures tressées, tout droit héritées des Vacances de la Comtesse de Ségur, grottes frémissantes ménagées, en terrier, sous les fins bambous servant de tuteurs aux « haricots ramés », pour s’achever sur la plus essentielle de toutes les demeures : la matrice primordiale de nos songes, l’île d’ombre mouvante qui répand, autour de lui, sur la crissante prairie, dans la touffeur zénithale des invincibles «étés ; le dôme gorgé de sèves et d’oiseaux d’un, châtaignier -notre ami l’arbre- pilier d’un Paradis longtemps renié, enfin retrouvé…suscité , sans doute…Ou bien- qui sait-ressuscité ? Michel Suffran. Août 1997.
Préface extraite du recueil de nouvelles « Demeures » de Lysiane Rolland – Éditions Les Dossiers d’Aquitaine. – Actuellement épuisé, mais peut être bientôt en cours de réédition augmenté de quelques nouvelles supplémentaires dont « La Maison du collectionneur ». Cette maison est celle de Michel Suffran nous vous invitons à la découvrir
 La maison du collectionneur.
La maison du collectionneur.
Nous arrivions dans une de ces rues bordelaises, bordées de maisons de pierres noircies, baignées d’effluves de pavés mouillés et de vin. Le ciel d’octobre était un dais gris entre les toits. Je cherchais le numéro 109 un peu fébrilement.
J’étais à l’heure. Je devais emmener l’écrivain à quelques dizaines de kilomètres, dans un lieu où se célébrait une joute littéraire, j’étais très fière et un peu intimidée, l’homme est connu, reconnu et son nom figure dans la moindre bibliothèque, je suis quant à moi quêteuse d’émotions.
Je sonnai au numéro 109, la maison, sœur de celles de la rue, était noire et imposante sans que rien ne laisse deviner la moindre particularité, un concert canin me répondit, les aboiements provenaient, semblait-il, d’un garage. Je tentai une ou deux paroles à travers la lourde porte, souvent, le son de ma voix ne déplait pas aux chiens, même inconnus. J’ai parfois remarqué dans leurs regards la lueur d’une compréhension, d’une connivence. J’ai le sentiment qu’ils savent mon attachement à leur compagnie. Aussi, je dis les quelques mots habituels, jusqu’à ce que les aboiements se transforment en gémissements, des chiens de petite taille certainement.
La porte d’à côté s’ouvrit cependant, une dame mince au regard chaleureux me dit d’entrer un instant, son mari finissait de se préparer. Je ne pus répondre, les mots d’usage, un pas à l’intérieur et je croisai le regard de l’enfant de porcelaine, juché sur un cheval à bascule, fin XIXè siècle. Plusieurs encore étaient regroupés, ceux de derrière ne dévoilant qu’une partie de visage, l’autre caché par les cheveux châtains de ceux de devant. Des poupées, des poupées par dizaines. Je ne vis d’abord qu’elles tant est puissante l’attraction que depuis toujours elles exercent sur moi, telle une clef magique sur les sentiments les plus purs, les plus cristallins, la source de l’amour que déploient les mains caressantes des petites filles. À travers temps, les poupées rendent vie aux visages disparus, aux intérieurs démodés, aux joues rondes et poudrées, aux sourcils en arc…
Je vis ensuite les marionnettes, les chevaux de bois, les livres d’images. En cette maison vivent tous les génies de l’enfance, dans le grenier propre et bien rangé, ne recélant que des trésors que tout chineur a un jour, osé imaginer.
Depuis longtemps, j’ai renoncé à pouvoir reléguer mes jouets au fond d’un placard ou pire, les jeter. L’idée de les perdre à jamais, disparus dans le temps et l’espace m’est insupportable. Ils trônent autour de mes livres, de mes meubles d’adulte, leur présence laisse des traces scintillantes dans l’air de ma maison. Je n’avais, jusqu’à ce jour, confié que très rarement cette impossibilité à quitter l’enfance, si proche de la porte de toutes les réponses. L’heureux étonnement de découvrir un intérieur si complice de ce que je vivais, coupable résignée, comme une faiblesse incurable, faillit m’arracher un cri de surprise. Secouée de rire au moindre souffle, une marionnette me dévisageait, moqueuse.
De regards en regards, nous étions arrivés dans une bibliothèque, la dame ne disait rien, compréhensive. Abasourdie et sentant qu’en cette maison, il était incongru de cacher ses émotions, je demandai la permission d’admirer les poupées, elle acquiesça d’un sourire et quitta la pièce, un cocker aux yeux d’ambre sur les talons. Je passai d’une merveille à l’autre trop rapidement certainement avec une gourmandise de voleuse de confiture.
Souvent, les brocantes me permettent d’emprunter par le truchement d’un objet, d’un vieux jouet, d’une revue, la porte du passé et l’espace d’un infime instant, je suis dans ce passé, je sais ce pouvoir des choses. Depuis toujours, j’essaie de prolonger ce temps volé, cette fois là, il rebondissait de la joue rosée d’un baigneur à la bouche cerise d’une grande fillette diaphane, puis à la lecture d’une revue d’enfant “Bob et Zette ” appuyée au cuir bombé d’un volume ancien.
Soudain, l’ombrelle pastel dessinée sur une couverture de livre d’enfant m’attira. C’était la collection « Marjolaine » des éditions Bourrelier, introuvable aujourd’hui, hormis dans quelques librairies spécialisées en ouvrages disparus. Ma main se tendait déjà vers ce joyau de mon enfance lorsqu’une voix joviale arrêta mon geste.
- Je suis prêt !
Je ne savais plus si j’avais devant moi l’écrivain de talent, le collectionneur assidu ou le petit garçon que je venais d’entendre chuchoter entre objets et livres, les trois assemblés en une personne affable qui parlait d’une bonne voix à son fils, lutin de cette maison aux trésors. Je ne sais plus pourquoi il m’emmena dans la cuisine où régnait un mur entier de boîtes en fer « Banania » ou « Pierrot Gourmand », il ne pouvait pas savoir que je ne me décidai pas à interrompre ma modeste collection de boites similaires. Je ne trouvais plus à caser sur mes étagères, une seule de ces reliques rouillées par endroit, aux dessins désuets, effacés ou palis, douces conteuses des épiceries ou des cuisines d’autrefois.
Je sus dans cette maison le défi superbe lancé au temps, à la vieillesse, au chagrin, à l’enfance que l’on dit perdue et que je découvrais vivante et si aimée de cet homme qui riait maintenant de mes surprises multipliées. J’allai ce jour là partout dans la maison où souriaient partout des visages d’enfants en porcelaine d’un temps inconnu de moi ou en celluloïd de mon enfance. J’essayai de ne rien perdre de ces fabuleux instants. J’eus même droit à caresser les petits chiens qui m’avaient accueillie, des chihuahuas à poils longs, mes djinns les appelait leur maître.
Nous discutâmes longtemps avant que je ne quitte les lieux, j’étais en terre connue, là où on se sent compris, je savais être transparente pour ce couple alors que la main de la dame de la maison effleurait en parlant la tête extasiée d’un ange de bois, gardien de la cage d’escalier.
Je repris ensuite mon chemin et ma vie et le petit rire d’un elfe rebondissait à chacun de mes pas sur les pavés, toujours brillants de pluie.
Lors de mes visites à Bordeaux, le bruit, les gens, le frôlement des êtres, des vies, des regards, créent en moi un désarroi qui fait que parfois je me perds, ou je remonte la rue Sainte-Catherine au sens opposé de ma direction. Je me réfugie alors dans une impasse parallèle, sombre et silencieuse, le temps de reprendre souffle, d’écouter la chanson de Bordeaux, cachée en ces ruelles, égayées d’un lierre clandestin, d’un étrange visage de pierre au-dessus d’une porte, ou du pigeon rassurant et débonnaire.
L’idée de la maison du collectionneur, nichée au cœur de la ville, abri de tant de merveilles, où règne l’esprit d’enfance et l’innocente bonté est désormais l’île, le havre, l’asile où je puise la confiance d’être moi-même sans concession.
À chacune de mes visites, je crains de découvrir que cette maison est un rêve, de ne trouver qu’un immeuble inconnu, de sonner et de me heurter à des regards porteurs d’une tendresse morte, de ne pas retrouver la merveilleuse complicité des habitants du 109.
Et pourtant, cette maison existe, contre toute attente, je sais qu’elle protège une pensée amie, rassurante et chaleureuse, présente dans la nuit de la ville.
Je fais appel à elle et reprends avec plus de force la terrible découverte des visages impassibles et fermés au long des rues hostiles. Lysiane Réginensi-Rolland (illustration Michel Suffran)

Michel Suffran,
est né à Bordeaux en 1931, rue Saint Rémi, rue populaire et commerçante située entre les quartiers « chics » du triangle bordelais et du Grand Théâtre, et à proximité de la place de la Bourse. Il est né là, un demi- siècle environ après François Mauriac lequel avait vécu son enfance, pas très loin, à quelques rues près, et tous deux ont souvent évoqués dans leurs ouvrages, les activités débordantes et les atmosphères particulières générées par le port tout proche qui était encore l’un des ports les plus importants de France ! Il passera également une partie de son enfance à Mézin, petite ville du Lot et Garonne, dont il gardera toute sa vie le goût de cette enfance passée à la campagne.
Il était médecin, une profession qui ne le destinait pas vraiment à la littérature et pourtant c’est à elle, que finalement, il consacrera l’essentiel de sa vie. Romancier, dramaturge, essayiste, son œuvre est importante : de l’essai littéraire au roman, en passant par de nombreuses pièces de théâtre, il a écrit également des scénarios originaux, produit des adaptations pour la radio et la télévision.
Outre l’écriture, Michel Suffran dessinait également entre autres des illustrations, notamment pour la réédition du livre « Le Drôle » de François Mauriac, avec lequel, malgré la différence d’âge (et peut -être à cause d’elle ?) il était entré en amitié !
Michel Suffran, a reçu plusieurs prix dont le Grand Prix littéraire de la Ville de Bordeaux, le prix Ardua en 2015. Il était membre de l’Académie des sciences, des arts et belles lettres de Bordeaux ; faisait partie de plusieurs jury de prix littéraires : Prix François Mauriac, Prix Montesquieu, Prix des Savoir-faire d’Aquitaine. Son œuvre est considérable, et pourtant Eugène Ionesco s’étonnait « Ébloui, angoissé encore plus, par le livre de Michel Suffran « La Nuit de Dieu » comment cet écrivain n’est-il pas mieux et plus connu ? » (ré.https://fr.wikipedia.org/windex.php ?titlt=Michel Suffran&oldid=150320569)
Et, oui pourquoi ? – Est-ce justement parce que cet écrivain était intemporel « hors mode » donc hors du tintamarre médiatique de la vie d’aujourd’hui ? Michel Suffran n’est physiquement plus près de ceux qui l’ont connu, aimé, mais il nous a laissé une œuvre, telle qu’en lui –même, empreinte d’humanité.
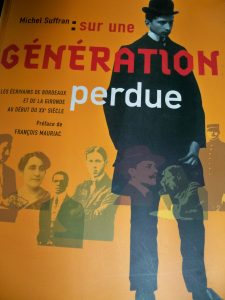 Ainsi ce livre ayant pour titre : Sur une Génération perdue… Les écrivains de Bordeaux et de la Gironde au début du XXè siècle.( Préface de François Mauriac).
Ainsi ce livre ayant pour titre : Sur une Génération perdue… Les écrivains de Bordeaux et de la Gironde au début du XXè siècle.( Préface de François Mauriac).
Ce fut le premier livre de l’écrivain, écrit en 1966, qui a été réédité en 2005 par les Éditions le festin. Ceux qui ne l’ont pas lu, nous les invitons à le faire, pour les autres à le relire et ce d’autant plus que ce livre entre en résonance avec ce Centième anniversaire de la Grande Guerre. Cette génération perdue ce sont aussi ces jeunes écrivains, contemporains et amis de François Mauriac, qui ont disparus lors de cette monstruosité que fut cette guerre. Plus jamais ça, disait-on ! On sait ce qu’il en est advenu !
Préface de François Mauriac. « Ce n’est pas vrai que nous mourrons seuls : nous emmenons avec nous ceux qui ne vivaient plus que dans notre cœur et dans notre mémoire. Dans quels cœurs et dans quelles mémoires continueront-ils à survivre, ces Bordelais qui furent jeunes quand je l’étais aussi.
Le plus aimé et le plus admiré , André Lafon : son art était très proche de celui d’un peintre aujourd’hui méconnu et que nous placions très haut lui et moi : Eugène Carrière. Qui saura, quand nous ne serons plus là, pénétrer dans cette poésie nocturne d’André Lafon, né du silence, et c’est au silence et à la contemplation qu’elle tendait et qu’elle l’eut ramenée invinciblement s’il avait survécu.
Jean de la Ville de Mirmont, peut-être la musique de Fauré portera-t-elle quelques temps encore ses poèmes. La musique de Fauré les épouse comme le grand fleuve courbe accompagne les mouettes autour des voiliers qui existaient encore pour les enfants bordelais nés en 1885. Jacques Rivière, le plus intelligent de nous tous…Ceux- là gardent leur chance. Mais Jean Balde- Jeanne Alleman- qui se souvient d’elle aujourd’hui ? Créature héroïque, contre laquelle s’est acharné ce qu’incroyant, j’aurais appelé un destin aveugle et féroce, et qui ne désarma même pas après sa mort- car du Casin , de cette maison de La Tresne au bord du fleuve qu’elle a tant aimée et où elle est morte, lentement dévorée, il ne reste pas pierre sur pierre et il est presqu’ impossible, me disait l’un de ses amis, d’en retrouver la trace. La vraie vie de Jeanne Alleman, telle que le dernier témoin que je suis pourrait la raconter, serait l’histoire d’une volonté tenace de bonheur que l’acharnement, que la patience du malheur n’arrivent à aucun moment à décourager – et en même temps c’est l’histoire d’une vocation de sacrifice total aux siens, acceptée, consentie, de l’adolescence à son atroce mort. Il n’empêche que son vrai drame, son vrai naufrage, fut dans l’ordre du cœur- mais le reste est silence.
Je m’attarde à Jean Balde. Je pourrais parler des Piéchaud dont le père fut notre médecin, quand nous étions enfants. Martial fut un de mes premiers amis, chez la sœur Adrienne, rue du Mirail : nous avions cinq ans. Chacune de ces vies constitue une histoire que je saurais raconter et qui serait vraie et qui ne le serait pas – car que savons-nous des êtres qui nous furent les plus proches ? Du moins pour ce qui touche André Lafon, je crois avoir donné dans « La Vie et la mort d’un poète » ma clé de son destin.
Et je crois que le livre de Michel Suffran constitue un relais nécessaire pour que lorsque nous ne serons plus là, une trace demeure, comme la marque de pas dans la neige durcie du temps révolu, et qu’en suivant, cette piste, de jeunes bordelais remontent jusqu’à « L’élève Gilles », jusqu’à « La Maison pauvre », jusqu’aux « Dimanches de Jean Dézert », jusqu’aux romans oubliés de Jean Balde, jusqu’à « La Trace de Dieu » de Jacques Rivière.
D’autres les aimeront, comme nous les avons aimés. François Mauriac.
-:-:-:-:-:-:-
Septembre, le temps de la rentrée littéraire…
C’est aussi le mois que choisit le festin pour publier le n° 107 de sa revue qui raconte en textes et en images, les grandes heures des Trente Glorieuses, telles qu’elles furent en notre Nouvelle -Aquitaine; des années 50 aux années 70. Un numéro pour les lecteurs qui ont connus cette période, et pour les générations plus jeunes qui l’évoquent sans toujours très bien savoir de quoi elles parlent. “…Les trente années qui s’écoulent de la fin de la Seconde Guerre mondiale au choc pétrolier de 1973, communément appelées les Trente Glorieuses, sont synonyme d’une forte période de croissance économique, de retour au plein-emploi, d’amélioration, des conditions de vie et d’un important essor démographique: le baby-boom”… La Nouvelle-Aquitaine, tout comme la France, se reconstruit et se modernise. Le territoire connaît des changements économiques et sociaux majeurs. L’urgence est alors de loger, ou de reloger ceux qui ont tout perdu ou vivaient dans des conditions insalubres, de créer et de structurer des équipements publics dédiés aux sport, à la culture, au vivre-ensemble et aux loisirs. Cette “révolution invisible”, pour reprendre les mots de l’économiste Jean Fourastié, se double d’une production industrielle et d’une consommation à outrance. La société évolue profondément et tend même à se réinventer avec les épisodes de mai 1968. La scène artistique connaît elle aussi un nouvel essor, avec une diversification des supports et des approches techniques, de l’abstraction au pop art, ainsi qu’une démocratisation du design et de la mode…

Les Trente Glorieuses, n° 107 le festin, parution le 14 septembre. 128 pages, prix: 15 euros. En vente dans les librairies et maisons de presse.

Beaucoup d’émotion à la lecture de ces quelques lignes qui m’ont happée !…. j’y étais sur le pavé des rues bordelaises et devant cette maison du “109”. Cela m’a rappelé un vécu similaire si cher à mon coeur ou je frappais aussi pour la 1ère fois au 6 Peyrelebade et pénétrais dans le monde de Lysiane et découvrais son Jardin de Mai.
Magnifique hommage à Michel Suffran cet homme hors du temps à la plume si délicate et au charme indéfinissable.
Merci Martine !